Luc Jeand’heur- 2003
Luc Jean d’heur 2003
Les peintures de Camille, bien qu’elles englobent les stigmates d’une culture visuelle contemporaine : de la photographie dans les cadrages et les compositions, du dessin animé dans le mouvement et le dessin, du cinématographe dans le flot et la stratification, de l’image scientifique dans le graphisme plat et simplifié, de l’image informatique réactive qui affiche une légende lorsque que le curseur du regard se pose un temps sur un objet, de l’industrie dans la nature artificielle des objets représentés, ne s’inscrivent pas dans la réalité sous-tendue par une photographie ou le signal vidéo.
Le parti pris de peindre renvoie à un rejet de ce que la réalité propose comme images, mais par contre joue la carte de la diplomatie en entretenant un certain nombre de relations formelles en usant de signes contemporains non spécifiques à la science de la peinture. Le choix
même du médium démontre une naïveté revendiquée.
De l’humour noir-pingouin, de l’énergie rose-salami, de la frivolité sans complexe : une insouciance vert-martien, Camille fait le plein de couleur. Elles font références à des goûts populaires, celui de la vanille chimique sur une langue tirée, ceux de bonbons acidulés et effervescents, ceux inédits d’un univers artificiel et incertain. Un exotisme de proximité qui joue la carte du lieu commun de son histoire propre. Libérer des correspondances insolites entre des choses, des formes, des couleurs, des mots et des délires à l’issue incertaine. En ce monde vivent les enfants qui le chérisse en riant, un paysage de sucre et de gomme où toute substance y porte en secret un nom donné par
l’adulte. Ils n’y éprouvent aucune inquiétude, juste la « légère narcose » du divertissement. Le grand Art de la peinture rencontre celui des petits plaisirs insensés que l’on laisse derrière soi.
Tous les goûts artificiels sont dans la nature. On est y conduit comme par ces enfants parlant leur langue étrangère qui vous emmènent par la main dans leur village étranger pour partager avec vous des jeux aux règles étrangères dans lesquels vous finirez bien par vous reconnaître vous-mêmes. On ne pénètre pas dans un monde objectif, un quotidien réfléchi mais bien dans un monde sensible, léger, joyeux, ambigu et farceur, une simulation toute de second degré : le pays de Camille.
Olivier Meyer - 2004
Camille Cloutier présente une série de toiles huiles et acryliques dont l’ordonnancement rythmique de l’accrochage invite à une lecture qui irait des grands formats vers les petits disposés en colonne, une « Tour » aux nombreuses connotations. Un accrochage sculptural. Ce qui impressionne d’emblée c’est le dynamisme saturé de la couleur qui malgré ses faux airs de pastel tend vers l’explosion de tons acidulées roses bonbons, vert pistache ou fluo, bleus guimauves, jaune vanillés, ludique alchimie tiré d’un conte d’apprenti sorcier qui aurait mélangé les pâtes d’une fraise Tagada et d’un Shamallow, salivées, régurgitées en une lumineuse palette que ne désavouerait pas le kitchissime Koons. De la peinture Shewing Gum, aussi appétissante qu’un gâteau à la crème de Thiebaud, aux armoiries « Haribo » qui afficherait sa comestibilité pour mieux séduire le spectateur par son immédiateté. Organique donc.
La couleur digérée, les figures des motifs ressortent nettement en aplats parfois surlignés sur un fond uni. On y reconnaît les éléments d’un vocabulaire codifié : valises atomiques, bâtonnets de glaces, trayeuse dentigène, semblant traiter en toute candeur d’anecdotiques rencontres avec le réel tout en ayant l’air de garder par delà la platitude de leur sourire de surface quelque inquiétant secret. Objets banals du plaisir ou emblèmes d’une geste originelle transfigurés par la fantaisie d’un regard puéril puis par le prisme nostalgique du souvenir adulte opérant dans l’épaisseur charnelle de la mémoire comme une biopsie pour en isoler les éléments restitués et les ériger en signes pictogrammiques. De l’anecdote (de l’accidentel) au tragique il n’y a qu’un pas surtout si ça se répète.
Mais dans le geste même qui fait affleurer la trace du souvenir à la surface de la toile, le fixant comme un signe, cette subjectivité se dérobe pour ne laisser subsister que la froide abstraction du signifiant, l’Idée de l’objet reréifié entrant dans le champ d’un nouveau langage, formel celui-ci. Le signe pictographique n’existant plus que pour lui-même offre en leurre son affinité avec une iconographie enfantine ou celle préenfantine des dessins animés. D’iconographie il devient iconologie.
D’une toile à l’autre les formes rondes et schématisées tendent à s’estomper jusque vers un informe grouillant. Seules quelques bribes d’écrits viennent explicitée de leur titre à posteriori l’histoire secrète qui s’y joue ou simplement sanctionner le fait que le tableau est achevé et élevé de ce fait à la dignité d’œuvre.
Fait explicité par la discrète et néanmoins ostensible présence des repentirs comme autant de stigmates résurgents sur la peau de la toile, rescapés entêtés d’une genèse dont ils sont les témoins. Histoire de survie ?
On en conclut que nous sommes devant une peinture qui au-delà du prétexte de ce qu’elle figure exhibe l’histoire de sa gestation sur laquelle elle parait interroger. Recherche formelle sur le terrain de jeux qu’est la toile. Recherche dans la composition jouant avec les limites du tableau, référence au cadrage cinématographique. Dynamisme du dessin animé dont les codes sont repris par traits, hachures, et pointillés restituant le mouvement, ou par des phylactères vidés de texte. Curseurs outrepassant leur fonctionnalité pour devenir éléments autonomes d’une lexicographie formalisante.
Du curseur informatique on arrive à l’imagerie technologique. L’artiste après ses études à l’E.S.B.A.M. a étudié le dessin anatomique classique et en a conclu que l’on pouvait plus représenter le corps de cette façon, elle s’est alors tourné vers l’image scientifique, celle microscopique des cellules, pour s’en inspirer, d’où cette grouillante présence de l’organique et cette rondeur patatoïdesque des formes. L’artiste se situe donc dans la problématique d’une énième reconstruction de la peinture à la lumière du zeitgeist ambiant.
Voir le monde avec des yeux d’enfant ou au microscope, faire de la peinture un terrain de jeu où l’on est libre d’inventer ses règles, se construire un refuge onirique, un monde immédiat, aussi appétissant qu’une friandise et les vignettes de son emballage où les lois de la pesanteur seraient réversibles telle serait la peinture de Camille.
Resterait à clarifier le rapport entre l’artiste, ce joueur illusionniste et le monde, commun et prosaïque et d’un rose pas forcément rieur, qui tape à la porte de son regarde si ce n’est de sa mémoire. En somme, le rose d’Alice au pays des merveilles ou celui télégénique du Meilleur des mondes ?
Sally Bonn - 2004
Sally Bonn, 2004
Il y a d’abord quelque chose qui cloche ou, si l’on préfère, qui ne tourne pas rond. Pourtant, de loin comme ça, ça a l’air simple, ça a l’air de tenir : des formes plus ou moins connues, reconnaissables, des contours clairement dessinés, des tons et des couleurs assimilables “en douceur”.
Mais malgré cela, il apparait comme une sorte de décalage, une impossible mise en phase. Le décalage ici tient à la légère distance entre cette reconnaissance aristotélicienne que nous croyons avoir des objets représentés (et le plaisir que nous en tirons qui correspond au plaisir que nous procure l’art, selon Aristote) et ces objets eux-mêmes, leur indistinction, leur indéfinition.
A y regarder de plus près, nous ne savons à quel registre ils appartiennent, que sont-ils, dans quel espace évoluent-ils?
Peut-être les titres sont-ils là pour donner une indication? Ces titres qui se sont déplacés, qui sont sortis du tableau, que nous disent-ils?
Que La fin et le commencement se sont touchés
Mais Après la pluie
Qu’il suffit d’un coup de Boogles
Pour qu’apparaisse Mondrian en 3D
Alors, au fond, Is it a Paul Smith?
Si les titres sont sortis du tableau, c’est que la narration vibre à présent sous la peinture: une narration qui fait peindre. Mais, quelle histoire ça raconte?
Pour qu’il y ait peinture, il faut qu’il y ait histoires, plusieurs types d’histoires auxquelles Camille Cloutier se confronte et se frotte:
D’abord, la grande histoire, celle de l’art, celle de la peinture, à laquelle aucun/aucune peintre ne peut se soustraire. Il faut toujours en passer par là, par jeux successifs de rencontres et de rejets, de découvertes et de fascinations, de soumission et d’affranchissement, de libération. Il faut bien pouvoir tordre le cou à Mondrian, même tendrement, à l’aide des constructivistes russes.
Puis, il y a la petite histoire, la sienne propre, celle de la peintre, celle qui fait peindre du moins, qui engage le geste, qui naît d’une forme ou d’un regard sur les choses, d’un détournement, d’une torsion du réel. Ce réel des objets quotidiens et moins ou quotidiens: bobines de fil, cerf-volants ou méduses, paniers, balais ou brosses-à-dents, tiges-tours aimants.
La petite histoire dont il s’agit ici n’est pas la petite histoire biographique ou plutôt si, mais dans la mesure où cette petite histoire est transformée par la peinture, où elle en passe par la peinture pour raconter quelque chose à la fois de l’enfance et du réel. De notre enfance et de notre réel à tous. Et je pense ici à ce que dit Gilles Deleuze de l’enfance dans l’Abécédaire à propos de cette vague biographique qu’il constate dans la littérature contemporaine (il s’agit des années 80): la petite histoire contre l’art. Camille Cloutier nous montre bien que l’on peut évoquer quelque chose de l’enfance sans qu’il s’agisse pour autant de sa ´"petite" enfance à soi, la sienne, en l’occurrence. Comme on peut évoquer quelque chose de la vie, du quotidien, du plaisir et que cela reste quelque chose de sérieux. Ou plutôt que l’on puisse évoquer quelque chose de sérieux et que cela puisse aussi, quand même être ludique.
- Et enfin, il y aurait ce qu’on pourrait appeler les histoires minuscules: celles qui naissent des formes elles-mêmes et qui vivent de leur propre vie de peinture, des formes qui se tordent alors qu’elles étaient figées, des rubans qui disparaissent sous la peinture, des formes qui se mangent et/ou se touchent, qui commencent ou finissent, des paniers ou charriots qui n’en finissent pas de se remplir. Et tout cela créé un monde, un monde de couleurs et de formes, un peu étrange, oui étrange, mais pas vraiment inquiétant.
Torsion – enlacement
Ruban apparraissant/disparaissant sous la couche de peinture, supposant par là une circulation à l’intérieur de l’espace à plusieurs dimensions (et non plus à une seule surface) de l’espace pictural, redonnant par là tout sons sens au mot espace. Espace pictural non comme une surface mais comme un espace en profondeur dans lequel les formes se meuvent de leurs propres facultés.
Camille Cloutier déjoue les catégories normatives du fond et de la forme, du sujet et de l’objet, du figuratif et de l’abstrait en proposant au regard une forme de “souriante étrangeté”.
Il y a dans la peinture de Camille Cloutier quelque chose de cette “étrangeté” que je me refuserais à trouver et nommer inquiétante, telle que la définit Freud qui lui-même l’emprunte à Schelling. Cette notion d’inquiétante étrangeté (à laquelle il faut mettre des guillemets virtuels) a été particulièrement et largement utilisée dans le discours esthétique et critique pour qualifier des formes artistiques très diverses (il serait intéressant, bien que laborieux et ce n’est ici ni le lieu ni le moment, de recenser les genres et formes d’art au cours du 20Ëme siècle ainsi qualifiés - mais ce n’est pas ici notre propos).
Cette “inquiétante étrangeté”, en allemand Unheimlich vient désigner à l’origine pour le philosophe et esthéticien de la fin du 18Ëme et début 19Ëme siècle Schelling: “tout ce qui aurait dû rester caché, secret, mais se manifeste”.
Freud reprendra près d’un siécle plus tard, en 1919, dans un ouvrage justement intitulé L’inquiétante étrangeté, cette notion pour définir le processus du refoulement.
L’inquiétante étrangeté devient ainsi la manifestation simultanée du sujet et du réel, ou encore le surgissement incongru au niveau des phénomènes, d’un substrat qui n’aurait dû se manifester que par le moyen d’un autre contenu de représentation.
Freud: “Cet unheimliche n’est en réalité rien de nouveau, d’étranger, mais bien plutôt quelque chose de familier, depuis toujours, à la vie psychique, et que le processus de refoulement seul a rendu autre. Et la relation au refoulement seul éclaire aussi la définition de Schelling d’après laquelle l’Unheimliche, l’inquiétante étrangeté, serait quelque chose qui aurait dû rester caché et qui a reparu”.
Je ne voudrais pas me lancer ici dans une analyse de type psychanalytique du travail de Camille Cloutier (parce que je doute en partie de la pertinence de ce type seule d’analyse autant à juger qu’à permettre de faire l’expérience de l’art), mais cependant il me semble que cette notion - avec ce qu’elle suppose d’une sorte de mélange d’accord et de désaccord entre les choses et les êtres qui les pensent, entre les formes et les êtres qui les créent – est à même d’éclaircir ou bien de soutenir le travail de Camille.
L’étrangeté apparaît aussi bien au niveau de ce qui vibre, sourd sous la toile, sous la peinture que dans les formes, les objets indéfinissables et pourtant, vaguement, reconnaissables : la peinture comme surgissement incongru au niveau des phénomënes, ou comme manifestation simultanée du sujet et du réel.
Quelque chose qui cloche – et c’est ce léger décalage qui produit une forme d’étrangeté ni inquiétante, ni rassurante mais vibrante et souriante.
Une souriante étrangeté, donc.
François Bazzoli - 2007
Pâte, crayons et pinceaux
L’exposition des peintures et dessins de Camille Cloutier aura fermé
ses portes le jeudi 30 novembre et vous n’y serait même pas allé. C’est
vrai que l’Espace Ecureuil de Marseille (Lieu de mécénat culturel de la
fondation d’entreprise Caisse d’épargne de la Région PACA) n’est pas
vraiment fait pour accrocher de la peinture, sa polyvalence
s’accommodant mal des procédés d’installation contemporains. Mais
« Saudade », qui se tenait du 6 au 30 novembre, semblait démontrer que
la peinture de qualité faisait fi des lieux et des conditions d’accrochage.
Composée d’un assemblage de peintures et de dessins, mais aussi des
titres des peintures et des dessins, si on peut dire, cette exposition
semblait pouvoir poursuivre plusieurs buts sous une seule apparence.
Montrer comment la peinture peut résister au lieu qui la supporte.
Prouver la vitalité d’une peinture qui ne soit ni soumise à l’image, ni
seulement esclave de l’expérimentation. Faire circuler à la fois la
référence la plus référentielle et l’air du temps le plus actuel.
Redonner un sourire aux pratiques mentales (puisqu’on ne peut
contrevenir au principe qu’elle est cosa mentale). Démontrer que la
génération Haribo sait utiliser la gourmandise de la couleur au service
de la pâte picturale. Faire en sorte que la question du titre déborde
du cartel afin de devenir chose en soi, commentaire sur la peinture en
général et bande-son de la peinture (et du dessin) de Camille Cloutier
en particulier.
En ce qui concerne la question du titre, ni gratuits, ni poétiques,
ceux des peintures et dessins de l’exposition semblent suggérer deux
voies parallèles : l’une où se mixent les interrogations picturales,
morales, mythologiques et référentielles (– Les géants habitent dans
les nuages – Eloge de la faiblesse – Le radeau de Géricault – Accident
de la conscience – Acis et Galathée – Exil – Repas de famille - Faire
sa place – Victor and Rolf). L’autre indiquant plus le contexte et
l’atmosphère, l’anecdote et la puissance de la parole, le jeu de mot
comme liaison (Ha ! ce « Drawin » hésitant entre « Drawing » et
« Darwin ».) et les dérives entre formes et sens (– Saudade – La
caravane – Marathon de la vie – Humain burger – Te huur - Mixture
intellectuelle - Exil en brochette – Drawin - Une autre face du monde).
Point de mots sur la toile, comme il y a quelques années. Le cartel
suffit.
Le mot pourrait, sans doute, affaiblir la comestibilité de la toile.
Moins évidente aujourd’hui, cette adéquation entre préparation de la
pâte picturale et la dégustation est toujours dynamique : dans le
geste, où la couleur s’étire comme guimauve ; dans la teinte, où les
stries et les couches retrouvent les stratifications savantes du
berlingot et des sucres d’orges ; dans l’ambiguïté de la thématique,
car plus besoin de peindre des pâtisseries pour que surnage cette faim
d’art et de peinture.
Maintenant établie à Bruxelles, Camille Cloutier a fait de sa pratique
picturale et dessinée comme un journal de bord, un espace sensitif qui
enregistre les repeints, les repentirs, les distorsions et les regards,
les repliements sur l’atelier et les respirations des ouvertures.
Osera-t-on parler,devant tant de gourmandise pour l’art de peindre, de
peinture feuilletée, au sens du journal de bord et de la pâte du même
nom ? Oui, on l’osera.
François Bazzoli
Luc Jeand’heur 2007
Checkpoint Camille
La peinture n’est jamais un fait accompli. De la taille d’un lit deux places qui se met en quatre, l’ « Exil » est un tableau repère d’un basculement. Il représente un baluchon de formes, toutes nées de la famille de motifs de Camille qui commenceront à être mis à mal (12 septembre, éloge de la faiblesse, le radeau de Géricault, à chaque fois refaire son lit). De plus en plus de gris et de blanc, des couleurs moins éclatantes, des restants de pelotes, des reliefs de pâtisseries, des cheveux de bonbons coupés en quatre, des fils de haricots magiques, des couches d’huile pigmentée comme autant d’allers-retours sur le motif, quelques nuages annoncent la fin des beaux jours des aplats et le sacre du désenchantement… comme si les couleurs radieuses, les formes généreuses, les titres volubiles, les repentirs réguliers ne faisaient que mieux représenter les malheurs de l’ailleurs tout en ne condamnant pas Camille à n’être que « conscience malheureuse » (accident de la conscience). Son vocabulaire pictural « classique » se reconnaîtra comme une sorte d’éden perdu, originaire et fondateur. Il demeure au centre de la toile et pourtant, on franchit la pure ligne exotique, le « tropique de Cloutier », sans disparaître de l’autre côté.
L’exil n’est pas une exténuation. Il oblige au contraire à une plus grande vigilance sur le monde et inspire à penser la complexité du réel. On voit plus clairement dans ses dessins récents la présence invasive d’une contemporanéité dévorante (Sangatte Cachan, exil en brochettes, monument aux morts). Si l’imaginaire de Camille est toujours présent, le regard échappe à sa systématisation. Il est de plus en plus hanté par les figures plus tragiques du monde, un ailleurs qui ne lui est pas étranger. Elle mord donc à pleine dents dans la chair du monde, dérive de ses images singulières et « dérêve » les figures métaphoriques du dedans (mon cœur mon cœur ne t’emballe pas). Elle convie son histoire à lui dans son histoire à elle, sans jamais se dépouiller de sa liberté de « ressemblance informe » et de son peindre-à-elle fragile. Point de pensée qui ne s’ancre dans le corps de la peinture de Camille, point de dessin qui n’émane de son enthousiasme et de son intensité.
Au-delà du pays de Camille comme Paradis perdu, sa pratique demeure le Vrai Lieu où se traduit un langage plastique. Car Camille est une artiste qui a et n’a toujours eu qu’une parole. Elle nous montre « d’ailleurs » qu’un véritable travail de refiguration permet de se réapproprier vraiment l’impensable poésie du monde. Son œuvre expose une sorte de journal de bord, une élaboration de l’après où se comprend une polyphonie : l’imaginaire propre des formes, les références picturales, les soubresauts du monde, les titres qui résonnent comme des légendes. Le principe dialogique nous apprend que « Les quatre aussi peut être un ». Toutes ces voi(x)es s’entregenèrent pour réconcilier tous les mondes. L’œuvre révèle la juste distance, entre le poétique et le politique, entre l’esthétique et le crime passionnel.
luc jeand’heur



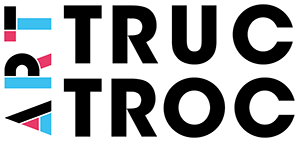


 …
…